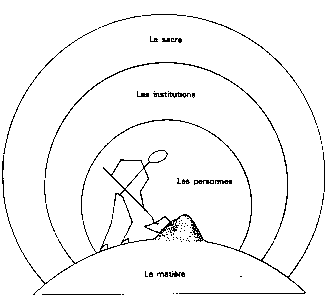Ce papier a été publié dans GERER ET COMPRENDRE, ANNALES DES MINES, décembre 1991.
EN QUÊTE DE THÉORIES
UN POINT DE VUE D'INGENIEUR SUR LA GESTION DES ORGANISATIONS
Pourquoi voit-on, en gestion, tant de choix apparemment
contraires au bon sens (par exemple, dans une mine,
exploiter de mauvaises couches et en laisser de bonnes à
l'abandon). Réponse: le comportement des gestionnaires est
localement rationnel. Chacun optimise les critères de
jugement qui pèsent sur lui. Des critères simples, gui sont
fixés et évoluent selon des lois intelligibles, mais dont
l'effet combiné peut effectivement défier le bon sens.
Les lignes qui suivent ont pour objet la vie des organisations, mais ni à la manière des sociologues. préoccupés de pouvoir, d'autorité et de liberté. ni à la manière des économistes. préoccupés de profits, de rendements et de productivité, mais avec une approche de naturaliste ou de mécanicien, à savoir: pourquoi les entreprises fonctionnent-elles comme elles fonctionnent ?
Cette présentation se déroulera selon le plan suivant:
- qu'est-ce que gérer?
- comment s'opèrent les choix?
- à quoi sont dues les crises?
Nous verrons que les crises sont un ingrédient inévitable de la vie des organisations, et qu'elles opposent en particulier trois acteurs-types: le fabricant, le commerçant et le financier. Cette analyse nous conduira à une classification des conseils et des théories en gestion. Nous conclurons sur les évolutions probables de ces questions dans les années à venir.
QU'EST CE QUE GÉRER ?
LES DEUX ABRÉGÉS
Parmi toutes les définitions imaginables de la gestion, nous partirons d'un énoncé aussi concret et vérifiable que possible, en disant que la gestion est l'activité consistant, au sein des organisations. à juger et à choisir, juger le passé et choisir pour l'avenir. Cette formulation soulève d'emblée deux questions: premièrement, comment identifier le détenteur de ce rôle: est-ce une personne, un groupe, une Institution? Laissons cette interrogation ouverte pour l'instant, et appelons agent économique cette entité qui choisit et qui juge.
Deuxième question: comment s'y prend-elle? Cette définition met en effet l'accent sur une perplexité essentielle: gérer, c'est d'abord s'interroger et, comme les philosophes l'enseignent, une telle interrogation est double: elle porte sur des jugements de faits et sur des jugements de valeurs.
En effet, il importe tout d'abord à l'agent économique de savoir où en est le monde et ce qui va se passer dans telle ou telle hypothèse. Autrement dit, qu'est-ce qui est vrai ?
Mais à supposer qu'il sache tout sur le passé, le présent et l'avenir. il est encore dans l'incapacité de formuler des jugements et des choix car il lui faut de surcroît disposer de critères d'appréciation du bien.
Or, par rapport aux autres situations humaines. la caractéristique de la gestion est la pauvreté des moyens dont dispose l'agent économique.
Il peut sembler audacieux de qualifier de pauvre le président d'une multinationale géante, mais il résulte de l'observation de la vie des dirigeants qu'ils manquent chroniquement de temps pour accomplir leur tâche. Ils fondent donc la plupart de leurs opinions sur des critères peu nombreux, sur des tableaux de bord sommaires, qu'on peut appeler des abrégés du vrai et des abrégés du bien.
Ces considérations permettent de définir plus précisément en quoi consiste la recherche en gestion telle que je la conçois: elle porte sur le contenu de ces deux sortes d'abrégés, leurs effets sur les choix, et leurs effets les uns sur les autres. Il faut entendre par là que s'il paraît naturel que le choix d'un critère du bien induise celui d'un critère du vrai (exemple: si l'on est convaincu que les meilleurs ingénieurs sont aussi les meilleurs en mathématiques, il paraît logique de les recruter selon leurs notes dans cette matière), il est en revanche plus inquiétant de déduire le bien uniquement de ce que l'on sait du vrai (par exemple, le principe fiscal: à revenu connu égal, impôt égal, entraîne sûrement de grandes injustices, mais que faire?).
Voyons à présent ce que les gestionnaires font de ces abrégés.
COMMENT S'OPÈRENT LES CHOIX:
LES TROIS PRINCIPES
La théorie proposée ici repose sur trois principes qui seront commentés et illustrés dans les pages qui suivent:
1. Un agent économique fonde ses jugements et ses choix, à un instant donné, sur un petit nombre de critères, en privilégiant les critères numériques;
2. Un agent économique établit logiquement ses choix de manière à optimiser les jugements dont il se sent l'objet;
3. Les critères qui fondent les jugements dont un agent économique est l'objet ont pour origines les caractéristiques techniques de sa tâche. et les normes institutionnelles et culturelles qui s'appliquent à ceux qui le jugent.
Le premier principe reprend le thème des deux abrégés, mais en ajoutant deux idées: leur caractère variable et le privilège des chiffres. Dans un tableau de bord, une indication peut rester absente ou inapercue jusqu'au jour où elle se transforme en signal d'alarme: une entreprise peut être confrontée soudainement à un péril financier, commercial ou social inapparent la veille.
Par ailleurs, les chiffres ont des propriétés de concision, de comparabilité, de possibilités de représentation graphique qui leur confèrent de grands avantages sur tous les autres modes d'expression. C'est ainsi que le chef d'État d'un pays moderne se sert pour l'essentiel de quatre chiffres (le PNB, l'inflation, le chômage et la balance commerciale) pour apprécier l'opportunité des choix qui lui sont présentés malgré l'imprécision et les biais dont leur mesure est affectée et malgré l'abondance d'informations qualitatives dont il est saisi par ailleurs.
Le deuxième principe livre une définition implicite de l'agent économique: c'est une entité qui se sent jugée sur ses choix. Considérons le cas d'un conseil des ministres, et supposons que l'ordre du jour appelle un affrontement entre le ministre de l'agriculture, qui défend les agriculteurs, et le ministre des finances, qui défend le budget. Voilà, typiquement, deux agents économiques jouant chacun leur rôle. Mais ce n'est vrai que pour un participant au conseil. Vis-à-vis de l'extérieur, seule la conclusion du gouvernement sera connue, et les deux ministres devront en faire état dans les mêmes termes vis-à-vis du public. Pour celui-ci, l'agent économique est le gouvernement dans son ensemble. On voit qu'une même personne peut avoir des attitudes et des comportements contradictoires sans nécessairement se renier.
Ce deuxième principe affirme quelque chose de précis: chaque agent économique est logique.
Autrement dit, nous sommes tous de bons élèves avides de bonnes notes. Jugez quel qu'un sur des tonnes, il fera des tonnes, sur des sous, il fera des sous. On pourrait penser avoir ainsi trouvé le secret du succès et de la fortune, mais encore faut-il pouvoir mettre en place l'instrument de jugement qui conduise à ce résultat. C'est la question abordée par le troisième principe.
Celui-ci énumère les conditions requises pour qu'un critère de jugement puisse être mis en place et fonctionner. Il faut d'abord que la quantité en question soit mesurable à un coût abordable. Par exemple, la production du métro parisien est comptée en voyages, parce qu'ils sont dénombrés: celle de la SNCF en voyageurs x kilomètres. parce que la SNCF vend des kilomètres et compte ce qu'elle vend.
Ensuite, il faut que les institutions acceptent, voire imposent le paramètre en question. Ainsi, il n'est pas possible de connaitre le solde des échanges entre deux régions de France, par exemple Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur.
En revanche, ce chiffre est encore mesuré entre la France et l'Allemagne grâce aux passages en douane et aux mouvements de devises, en dépit de l'existence de la CEE.
Enfin, un critère de jugement ne fonctionne que s'il est culturellement tolérable. Par exemple, il est courant aux Etats-Unis d'afficher la liste des revenus imposables des habitants d'une ville: en France. cela violerait un tabou.
Ce troisième principe comporte encore une indication importante, celle de la transitivité des jugements.
Chacun juge son prochain au nom du fait qu'il est jugé lui-même, car c'est de là qu'il tire le droit, voire même le devoir, de juger autrui.
Par exemple, l'adjudant dit au caporal: " Cette chambrée est une porcherie, mettez-moi ça en ordre: vous savez que le capitaine est à cheval sur la propreté " .
A toutes ces conditions pour qu'un critère de jugement fonctionne, il faut en ajouter une autre, qui se repère à une petite nuance de vocabulaire entre le deuxième et le troisième principe: dans le troisième l'agent est jugé, dans le deuxième l'agent se sent jugé.
Il est clair en effet que l'agent réagit logiquement en fonction de ses singularités personnelles: un responsable à la veille de la retraite ne se sent pas concerné comme un jeune à la veille d'un avancement au choix.
Cette théorie des décisions dans l'entreprise peut être lue comme un système de lois analogues à des lois naturelles, mais aussi comme un ensemble de réfutations d'idées fausses:
- le premier principe vient mettre à mal le mythe du «manque d'informations». Il suggère en effet qu'avant de multiplier saisies de données, moyens de calcul et de transmission, il est sage de prendre conscience que chacun ne se sert ultimement que de trois ou quatre chiffres, et de se demander s'ils seront réellement plus pertinents après qu'avant;
- le deuxième principe vient refuter le mythe selon lequel l'entreprise aurait une rationalité globale, par exemple la maximisation du profit, mais que ses collaborateurs seraient irrationnels en ne servant pas cet objectif, par manque de compétence ou de civisme. Il affirme au contraire que chacun est logique et dévoué, mais il ne postule aucune cohérence entre toutes ces rationalités locales;
- le troisième principe met en garde contre les intentions de réformes irréfléchies, en soulignant le fait qu'un système de jugements est maintenu en place par des forces puissantes et diverses, et que les innovations en la matière doivent répondre à des conditions exigeantes.
Voyons à présent sur un exemple réel comment s'appliquent ces idées.
LES MAUVAISES TONNES AVANT LES BONNES
Un dirigeant des Charbonnages nous consulta un jour sur un paradoxe choquant: à cette époque, le prix de plus en plus bas des hydrocarbures condamnait les houillères à la régression, et l'on observait qu'à chaque fermeture de mine de belles ressources étaient partiellement abandonnées tandis que les mauvaises avaient été extraites jusqu'à la dernière tonne.
Un examen attentif des choix au jour le jour des exploitants révéla que cette hérésie économique était la conséquence logique d'une pratique de gestion pourtant bien naturelle: la mesure quotidienne de la production. Comme les dépenses d'un siège minier sont pratiquement intangibles à court terme, le coût de revient est d'autant plus bas que la production est élevée. Celle-ci est donc surveillée avec soin: lorsqu'elle fléchit, le responsable est rapidement mis en garde.
Une indication sur les conditions techniques de l'exploitation va faire comprendre comment le drame se jouait. Les mauvaises ressources sont caractérisées par une tectonique tourmentée: le charbon, initialement sédimenté en couches horizontales régulières, s'est trouvé déformé et tronçonné au cours des millénaires par les mouvements du sol, de sorte qu'il peut, de manière peu prévisible, disparaître pendant des dizaines de mètres ou réapparaître en volumineux amas. Les bonnes ressources, au contraire, sont planes et régulières et on peut aisément mécaniser leur abattage avec des frais variables réduits.
On devine alors le comportement de l'exploitant rationnel: son but est, pour éviter reproches et menaces, de stabiliser la production quotidienne. La production se déroule usuellement sur deux postes: 6 h-14 h, et 14 h-22 h. A 6 h, il met le gros de ses troupes dans les mauvaises ressources. Si, à 14 h, la production est suffisante, il termine la journée sans changement. Si, en revanche, il manque du tonnage, celui-ci est réalisé sans trop d'aléas dans les bonnes couches. C'est ainsi que la production est stabilisée. mais à un coût qui cumule les frais de main-d'oeuvre des mauvaises ressources et les frais d'équipement des bonnes.
On voit ainsi opérer un abrégé du vrai, le tonnage quotidien, et un abrégé du bien, le déficit à la tonne. ainsi que les effets pernicieux du premier sur le second. Le fonctionnement des deux premiers principes apparaît également à l'évidence. Le troisième apparaîtra plus clairement après sa présentation sous une nouvelle formulation: celle des quatre niveaux.
LES QUATRE NIVEAUX ET LEURS DÉCALAGES
Il est commode de résumer le troisième principe sous forme d'un schéma. S'y trouve représenté l'agent économique le plus général agissant sur la nature à l'aide de l'outil le plus général, et quatre zones sont distinguées dans cet espace:
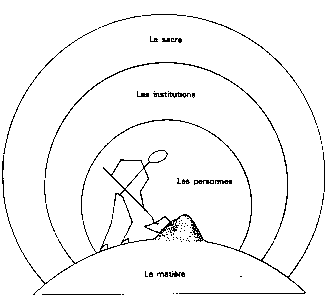
- la matière: c'est tout ce qui, à un instant
donné, ne souffre pas de discussion, comme le
champ de la pesanteur, la résistivité du cuivre
ou le prix du pétrole;
- les personnes: c'est tout ce qui peut
changer quand on remplace un individu par un
autre;
- les institutions: c'est l'ensemble des
comportements permis, interdits ou
obligatoires, parce que c'est écrit quelque part;
- le sacré: autre dénomination des normes
culturelles, cela désigne le permis, l'interdit ou
l'obligatoire qui ne sont pas même écrits.
Le troisième principe peut alors s'interpréter par le fait que tout paramètre de gestion est accroché à chacun de ces quatre niveaux. C'est particulièrement visible dans l'affaire des mauvaises tonnes avant les bonnes.
En effet, dès que l'analyse ci-dessus fut reconnue valide, on se préoccupa de trouver un remède, et celui-ci s'imposait à l'évidence: supprimer la mesure quotidienne de la production, pour la remplacer par une mesure moins fréquente, hebdomadaire ou mensuelle. Les exploitants pourraient alors extraire en priorité les bonnes ressources, et réduire ainsi les effectifs du personnel, quitte à affronter des baisses temporaires de production à l'achèvement d'un bon panneau. Mais tous les niveaux opposèrent des résistances:
- la mesure de la production quotidienne est automatique: il suffit de compter les berlines extraites: il aurait paru étrange de supprimer un instrument de contrôle si simple et commode;
- la production de la veille est un sujet de conversation de chaque jour pour tous les ouvriers et cadres, une habitude de pensée ancrée dans leur pratique professionnelle;
- c'est un chiffre souvent réclamé par les nombreuses tutelles administratives et politiques des houillères;
- chaque chef d'exploitation y attache, depuis ses débuts dans le métier, une importance privilégiée.
Il faut s'arrêter sur ce dernier point pour comprendre en quoi il relève du sacré. C'est dans les années 50 que la plupart des responsables concernés avaient débuté. En ce temps-là, le charbon était de loin la première ressource énergétique nationale, et il n'était pas question de déficit, encore moins de fermeture. L'impératif était de maximiser la production quotidienne et toutes les ressources étaient bonnes à prendre. Cela se traduisait par des consignes pleines de panache du genre: on n'abandonne jamais du charbon au fond, ou bien "Là où la lampe passe, le mineur passe" (une lampe traditionnelle mesure une trentaine de centimètres de haut). En ce temps- là, la tactique quotidienne expliquée ci-dessus était la plus à même d'entraîner la saturation des puits d'extraction, et par conséquent la plus rationnelle pour l'époque.
La crise dont l'étude précédente témoigne peut alors s'interpréter comme le résultat d'un décalage entre les quatre niveaux: le sacré et les institutions étaient restés bloqués dans un état ancien, tandis que la matière, le charbon, s'était modifiée, perdant peu à peu sa nature de ressource prioritaire et rentable.
Plus généralement, il est commode
d'utiliser ce schéma des quatre niveaux
comme moyen d'analyse des crises. On peut
proposer une analogie avec le jeu du jack pot,
ce jeu de hasard composé de quatre cylindres
co-axiaux décorés à leur périphérie de
figurines variées. Le jeu consiste à mettre les
cylindres en mouvement, et le gain est acquis
si la position d'arrêt est peu probable, comme
quatre citrons alignés. Ainsi, une situation
jugée favorable pour un observateur dans une
organisation peut s'interpréter comme le
résultat d'un alignement, de son point de vue,
des quatre niveaux; c'était le cas des houillères
dans les années 50 pour la quasi-totalité de
l'opinion publique.
Mais, à la différence du jeu du
jackpot, les niveaux bougent ici selon leur vie
propre: la matière évolue physiquement ou
économiquement, les personnes vieillissent et
changent de fonction, les lois et règlements
sont renouvelés et la culture elleméme connaît
des ruptures. Alors des tensions s'introduisent
à chacune des interfaces concernées,
entraînant des désirs de réformes, et parfois
des séismes.
Un exemple illustratif est l'irruption
de l'informatique dans la banque. La banque
est l'empire du chiffre, et les ordinateurs y ont
tôt fait leur apparition. Mais rare était le
personnel capable de les faire fonctionner. Il
fallait le trouver sur le marché du travail mais
les exigences salariales des informaticiens
confirmés conduisaient à les payer plus cher
que des cadres anciens, ce à quoi institutions
et règles culturelles répugnaient. On ne
trouvait donc que des jeunes qui restaient peu
de temps et partaient avec leur savoir-faire.
Ainsi donc une évolution de la matière (apparition d'un outil nouveau) suscite une crise au niveau des personnes (pas de techniciens disponibles), ce qui met en porte-à-faux une institution (l'échelle des rémunérations), dont la réforme éventuelle est bloouée par le sacré.
Le point de départ des crises peut se trouver dans chacun des niveaux. Les deux précédentes (la mine et la banque) provenaient d'une évolution de la matière, mais on peut citer des crises provoquées par une mutation culturelle (par exemple mai 1968), par une mutation institutionnelle (par exemple les lois sociales du Front Populaire), ou par un changement de personne (apparition ou disparition d'une forte personnalité).
Mais à côté des crises provoquées par des évolutions dans le temps, il en est d'autres qui sont chroniques, inscrites dans la structure même des organisations, comme on va le voir à présent.
LE FABRICANT, LE VENDEUR, LE FINANCIER
Toute institution est un lieu d'affrontement entre agents aux logiques incompatibles et, à partir de l'exemple d'une entreprise industrielle, on peut dresser le portrait des agents les plus typiques: celui qui produit, celui qui vend, celui qui emprunte.
Le fabricant est un acteur épris de permanence. Il utilise des machines coÛteuses et conçues pour durer, il met du temps à mettre au point ses procédés et former son personnel. Une grande partie de ses dépenses, comme dans l'exemple de la mine, ne varie guère avec la production, de sorte qu'il redoute les interruptions dues, entre autres, aux changements de produits.
Le vendeur, par contraste, est épris de changement. Son rôle est de séduire un client a priori exigeant et infidèle, et son idéal serait de disposer d'un produit, d'un délai et d'un prix adaptés à chaque cas.
Il est clair que le conflit entre ces deux acteurs est inévitable, qu'il soit explicite ou latent. Le vendeur attend du fabricant qu'il lui fournisse ce qu'il peut vendre, le fabricant préférant à l'inverse considérer le vendeur comme chargé d'écouler ce qu'il fabrique.
Un troisième agent observe ces affrontements avec inquiétude, c'est le financier. Son rôle consiste, schématiquement, à emprunter de l'argent pour payer les machines du fabricant, et à rembourser les créanciers avec les produits de l'activité du vendeur. Pour réussir, il doit se montrer, vis-à- vis de l'extérieur, confiant dans les performances de ses deux compères, ce qui sera d'autant plus facile qu'il donnera moins au premier et demandera plus au second.
Ces trois protagonistes, ont évidemment un patron, directeur général ou président, dont le rôle est d'arbitrer. Mais, à supposer même qu'il dispose pour cela d'un critère tel que le profit, bien difficile à définir au demeurant, il peut y satisfaire de plusieurs manières en donnant la préférence à tel ou tel: la même entreprise en difficulté peut être sauvée, le cas échéant, par un fabricant, par un commerçant, ou par un financier de génie.
Les quatre niveaux caractéristiques de chacun de ces agents expliquent leurs divergences. Par exemple, en matière d'institutions, le paramètre comptable qui juge le fabricant est classiquement un coût de revient, et celui qui juge le vendeur un chif fre d'affaires. Or, varier les produits et raccourcir les délais de livraison pour accroître le montant des ventes a pour effet mécanique, on l'a vu, de détériorer le coût de revient, puisque cela met en péril la saturation des machines.
Deux à deux, ces trois agents
s'affrontent donc, et l'on peut même observer
des points triples. C'est ainsi qu'une entreprise
d'armement maritime fut le siège d'un vif
débat sur le point de savoir ce qu'il fallait
retirer du résultat annuel au titre du «maintien
du patrimoine». Trois points de vue
s'affrontaient: les exploitants comptaient en
nombre de navires, car leur souci est
d'employer officiers et équipages; les
commerçants comptaient en parts du
marché. ce qui suggérait des besoins
d'épargnes différents selon l'évolution des
diverses lignes, et les financiers comptaient en
remboursements des emprunts. Ces
évaluations différaient grandement et l'enjeu
n'était rien de moins que le calcul des résultats
à distribuer aux actionnaires en dividendes et
aux collaborateurs au titre de l'intéressement.
On peut retrouver des affrontements
analogues dans des institutions qui ne sont pas
industrielles et commerciales. Par exemple,
dans une mairie, on observe classiquement un
conflit d'intérêt entre les élus, comparables aux
vendeurs par leur besoin de séduire leurs
mandants, et les permanents, secrétaire
général et directeur
général des services techniques, analogue:
aux fabricants par leur souci de stabilité dans
la gestion des moyens de la ville. De même,
dans un hôpital, le directeur, gardien de l'ordre,
est chroniquement affronté au corps médical,
toujours friand de nouveautés. Ici et là, on
trouve en plus un financier gestionnaire des
emprunts et des remboursements.
Ces considérations montrent que fabricant et commerçant s'opposent notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes échelles de temps, et que des oppositions de ce genre peuvent se rencontrer dans toutes les organisations, même si elles ne fabriquent ou ne vendent rien à proprement parler. De plus, à l'intérieur d'une même fonction, différentes conceptions de la durée peuvent s'affronter. C'est particulièrement visible chez les financiers où spécialistes du court terme et du long terme raisonnent selon des logiques fort différentes tout en maniant les mêmes ressources.
Plus généralement, la considération
du triangle fabricant-commerçant-financier
laisse dans l'ombre d'autres fonctions souvent
importantes, comme la R et D, l'informatique
ou la formation. De plus, chacun de ces trois
agents s'analyse à son tour. On l'a vu à
l'instant dans le cas de la finance. De même, à
l'intérieur de la fonction fabrication, on peut
observer des affrontements entre
l'exploitation, les méthodes, la maintenance,
etc. L'analyse précédente n'a donc pas une
portée opérationnelle directe; elle vise
seulement à illustrer, à partir du schéma à
quatre niveaux, l'irrémédiable incohérence qui
caractérise la vie des organisations.
Toutefois, les trois fonctions ainsi
privilégiées existent même dans les
entreprises les plus frustes, et elles offrent une
grille efficace, conjuguée au schéma à quatre
niveaux, pour analyser idées et publications
ayant trait à la gestion, comme on va le voir à
présent.
LES DOUZE CAGES À IDÉES
Propos entendus dans une entreprise en difficulté: "Ce qui ne va pas, c'est le produit", "Impossible de trouver les hommes qu'il nous faudrait", "La bureaucratie nous paralyse", "Les mentalités ne sont pas adaptées aux problèmes du jour".
Ces quatre diagnostics renvoient aux
quatre niveaux de la figure précédente et ont pu, le cas
échéant, avoir été prononcés à propos de la
même entreprise. Il est même probable qu'ils
ont tous une certaine pertinence. Si l'on retient
en effet l'hypothèse qu'une crise peut
s'interpréter comme un décalage entre deux
niveaux ou plus, la réduction de tels décalages
peut s'opérer en agissant sur l'un ou l'autre des
niveaux concernés.
Par ailleurs, les crises se manifestent
aussi par des affrontements entre agents, et
les remèdes, là encore, mettent l'accent sur tel
ou tel d'entre eux. Par exemple, l'action sur le
produit préconisée ci-dessus peut s'interpréter
comme une action technique (même produit
pour le client, mais amélioration de son coût de
revient), une action commerciale (changer le
produit ou son mode de distribution) ou une
action financière (prise en compte du risque
d'impayés ou du risque de change selon les
productifs).
Comme pour les décalages entre
niveaux, les affrontements pernicieux entre
agents peuvent se résoudre, on l'a vu, aussi
bien par des progrès commerciaux que par
des progrès techniques ou financiers. Il est
d'ailleurs à noter que chacun formule un diagnostic en cohérence avec le remède qu'il a
présent à l'esprit.
| | A
La fabrication | B
La vente | C
Les finances
|
| 4. Le sacré
|
|
|
|
| 3. Les institutions
|
|
|
|
| 2. Les personnes
|
|
|
|
| 1. La matière
|
|
|
|
Nous voici donc en présence d'un tableau à double entrée : en colonnes, trois agents: en lignes. quatre niveaux: soit au total douze cases. On peut voir que les conseils en gestion ont tendance à se confiner à un petit nombre de ces cases, parfois à une seule.
Ainsi, les trois hypothèses envisagées
ci-avant à propos du produit renvoient
respectivement aux cases 1A, 1B et 1C. De
même, on entend couramment des affirmations
telles que: "il faut introduire dans les ateliers la religion de la qualité" (case 4A), "il faut motiver nos vendeurs par des primes plus stimulantes" (case 3B), "ce qu'il nous faudrait, c'est un de ces virtuoses des marchés financiers à court terme" (case 2C), etc.
Notons que les lignes évoquent des
corps de pensée, voire des disciplines
académiques bien distinctes: le niveau de la
matière évoque les sciences physiques et les
technologies, celui des personnes la
psychologie, celui des institutions le droit,
notamment les disciplines comptables, et celui
du sacré la sociologie, l'ethnologie, la
philosophie et l'histoire. Il est naturel, lorsque
l'on souhaite appliquer le savoir formalisé à la
résolution des problèmes de l'entreprise, de
mettre sa confiance dans le corpus de
disciplines que l'on préfère.
Or, il est manifestement imprudent de
trop attendre d'une action ne portant que sur
un seul niveau, car rien n'assure que le résultat
obtenu sera en harmonie avec l'état des trois
autres. On s'est d'ailleurs avisé depuis
longtemps de certaines interactions
importantes. Par exemple, l'ergonomie se
donne pour objet la relation hommes-machines; la psychosociologie aborde
simultanément les personnes et les institutions
en considérant la vie des groupes, et l'on peut
recenser d'autres efforts pour traiter telle ou
telle interface; mais il ne s'agit jamais que de
prendre en compte deux niveaux, et l'esprit
humain est malhabile pour raisonner sur plus
de deux réalités en même temps.
Or, les niveaux et les agents oubliés
se vengent. Mettre un excellent administrateur
à la tête d'une entreprise en difficulté peut
conduire, comme on sait, à une faillite bien
administrée. Son action a pu se concentrer sur
la rigueur des procédures en matière
financière (case 3C), tandis que la qualité des
produits, les ventes et le moral des troupes
s'effondraient.
Cette concentration déraisonnable
des efforts sur un sous-ensemble restreint des
problèmes de l'entreprise est caractéristique des phénomènes de modes. Tour à tour,
les chronométrages inspirés de Taylor, les
chaines de montage inspirées de Ford, la
psychologie appliquée, la comptabilité
analytique, les ordinateurs, le marketing, les
robots ont été présentés par les médias et les
consultants comme des panacées. Il est
malaisé de faire le bilan de ces raz-demarées,
car les entreprises sont discrètes sur leurs
erreurs, comme celui des bienfaits durables
qu'elles en ont retirés, car les acquis entrés
dans les moeurs deviennent invisibles.
L'importance de ces phénomènes est
aisée à comprendre. Dans une organisation en
crise c'est, parmi les réformes envisageables,
celle qui est portée par l'air du temps qui sera
la plus facile à mettre en oeuvre. Mais rien ne
garantit que l'ajustement souhaité se produira,
ou qu'il ne provoquera pas d'autres décalages
annonçant de nouveaux séismes. Sans doute y
a-t-il ainsi des configurations sans issue, des
cascades irrémédiables de séismes
dévastateurs, ce que suggèrent certains
acharnements thérapeutiques dont la presse se
fait l'écho.
La sagesse voudrait donc, face à
chaque crise d'une organisation, que les
responsables considèrent toutes les cases du
tableau et leurs interactions. Mais le manque
de temps qui explique le jeu des abrégés rend
la somme de réflexions et de dialogues
correspondante hautement improbable, et
l'évolution de la vie des affaires dans les
dernières décennies a encore aggravé la
difficulté, comme on va le voir.
SOUS LE RÈGNE DE L'URGENCE
Un industriel du textile faisait récemment observer: "Dans mon métier, soit on fait du fil ou du tissu, et l'on doit posséder de grosses machines, soit on fait des vêtements, et l'on doit employer une nombreuse main-d'oeuvre. Dans les deux cas, il est très difficile de changer de fabrication en peu de temps. Or, la mode est si fluctuante que pour gagner de l'argent, il faut livrer en quelques jours une marchandise nouvelle qui sera peut-être invendable au bout de peu de semaines. Il vaut donc mieux sous-traiter, le cas échéant en pays à main d'oeuvre bon marché, car il est plus facile de changer de fournisseur que de modifier ses propres fabrications". On a constaté en effet, dans le textile comme dans de nombreuses autres industries, un éclatement sous
forme de réseaux de sous-traitants de grandes
unités de production jadis intégrées, le maître
du réseau ne fabriquant parfois plus rien par
lui-même mais contrôlant un point-clé, par
exemple la conception ou la distribution.
Certains, toutefois, sensibles aux
inconvénients de la délocalisation, sont
revenus à une fabrication sur place. mais
selon les méthodes nouvelles fondées sur les
flux tendus, afin de réagir sans délai aux
demandes du marché.
Par rapport aux analyses
précédentes, ces remarques suggèrent que le
niveau de la matière, aussi bien du point de
vue du commerce que de celui des
fabrications, est soumis à des changements
d'une fréquence et d'une brutalité inconnues
des périodes antérieures, et rien ne donne à
penser que ces phénomènes vont s'atténuer à
l'avenir.
Ceci conduit à des décalages
nouveaux dont nous allons sommairement
évoquer les caractères et les effets.
Au niveau de la matière elle-même,
les situations d'équilibre, où prix de vente et
coûts de revient tendraient à se rejoindre,
laissent de plus en plus la place à des
successions de rentes éphémères, fruits
d'innovations réussies, et de naufrages.
L'information économique devient une denrée
de plus en plus périssable et la vigilance
rivalise toujours davantage avec la réflexion
comme facteurs de succès. C'est
particulièrement sensible en finance, où les
mouvements à court terme ont pris une telle
ampleur que pour un dollar qui achète une
marchandise, il en circule aujourd'hui quarante
qui ne véhiculent que des promesses.
Les personnes sont plus ou moins
armées pour faire face à ce monde
tumultueux. Il favorise les détenteurs de
privilèges, de goûts et de talents très
inégalement répandus.
Les institutions, dont le niveau est a
priori le plus inerte puisqu'elles sont
déterminées par des lois et des règlements, se
trouvent particulièrement bousculées par ce
nouvel état de fait. La nécessité de saisir
l'information et y réagir au plus vite met en
péril les hiérarchies à nombreux niveaux et les
communications ritualisées. Le succès va aux
petites unités autonomes et informelles, ce qui
pose de difficiles problèmes de cohérence
interne aux grandes entreprises et aux
administrations publiques.
Le niveau du sacré semble sollicité
pour suppléer les carences des institutions. Il
n'a jamais été autant question de culture
d'Entreprise que depuis que les arborescences
bureaucratiques sont mises à mal. Il s'agit sans
doute de retrouver dans du nonécrit les
principes de cohérence que les règlements ne
peuvent plus sauvegarder. Les succès en la
matière sont inégaux. et peut-être faut-il
chercher dans cet affaiblissement des
structures d'entreprises et des appareils d'État
le regain de faveur dont font l'objet les cultures
locales et régionales et les religions
traditionnelles, comme si les personnes
cherchaient à y retrouver des principes de
permanence que la société économique et
politique leur refuse désormais.
Ces remarques ne poussent a priori
ni à déplorer ces évolutions ni à s'en réjouir.
Certains, comme T. Peters et R.
Waterman, dans Le prix de l'excellence,
sans doute le best-seller du siècle parmi les
livres sur la gestion, exaltent les vertus des
organisations conviviales et dynamiques qui
réussissent dans ce nouveau climat, d'autres
mettent en avant la multiplication des exclus
que ces victoires laissent sur le champ de
bataille. Pour nous, tout est affaire de
cohérence et fonction de l'observateur. C'est
sur cette neutralité, qui n'est pas de
l'indifférence, que nous voudrions à présent
conclure.
UNE THÉORIE NEUTRE
MAIS EXPLICATIVE
La théorie exposée ci-dessus est
foncièrement neutre, laïque, indifférente aux
grands enjeux de l'époque. Le mot de pouvoir
n'y figure pas, ce que certains regretteront car,
nous l'avons vu, c'est la grande affaire de la
sociologie. Tout au plus invite-t-elle à
examiner, en suivant les quatre niveaux, si la
relation désignée par ce mot de pouvoir est
dictée par les impératifs de la matière, par
l'ascendant d'une personne sur d'autres, par
une disposition législative ou réglementaire ou
par un attribut de nature culturelle dont
bénéficierait son détenteur.
De même, cette théorie est à peu
près muette sur les objectifs économiques tels
que la maximisation du profit. Elie invite
seulement à examiner quel est l'instrument de mesure par lequel le profit en
question est repéré, avec quelle fréquence,
et qui se sent jugé sur cette mesure.
Elle ne permet pas non plus de se
prononcer sur les mérites respectifs des gestions à la japonaise, à l'allemande ou à
l'américaine, à supposer, ce qui n'est pas
certain, que ces expressions désignent des
systèmes bien précis.
Mais elle n'en a pas moins une
grande puissance explicative à l'égard des
succès, des crises et des échecs. Elle enseigne en effet que toute gestion jugée bonne
réalise une cohérence satisfaisante entre
divers ordres de réalités, et que plusieurs
combinaisons sont concevables pour obtenir
un tel résultat. C'est ce que semble confirmer l'Histoire, dans la mesure où elle
raconte la grandeur et la décadence d'empires très différents par leurs géographies,
leurs populations et leurs normes institutionnelles et culturelles. Elle met aussi en
garde contre les transpositions irréfléchies
de tel ingrédient d'une expérience réussie
dans une configuration différente, erreur
que les échecs répétés de la lutte contre le
sous-développement viennent douloureusement illustrer.
A un niveau plus quotidien, cette
théorie peut rendre les mêmes services
qu'un traité de physiologie animale ou végétale. Elle considère l'entreprise comme une
entité vivante composée de fonctions qui
peuvent être satisfaites de manières diverses, mais pas dans n'importe quelle condition.
C'est à partir du jour où l'on a commencé à considérer le corps humain de cette
manière, comme le siège de réactions
physico-chimiques plutôt que comme le lieu
de l'affrontement obscur des humeurs, que
la voie s'est ouverte pour la médecine moderne. C'est à une ambition de ce genre en
matière de gestion que cette théorie pourrait servir.
Note méthodologique
L'exposé qui précède ne relève pas de
la tradition académique. En effet, l'auteur
n'est pas parti d'un état du savoir tel que
pouvait le refléter la littérature, pour en
déceler les insuffisances et s'efforcer d'y
remédier. Le point de départ a été d'une
autre nature: il a consisté, vers la fin des
années 60, à mettre en oeuvre dans les
entreprises les méthodes et les outils
familiers aux ingénieurs, en particulier la
recherche opérationnelle et le calcul économique, pour améliorer leur gestion.
Au fil des années, terrains, succès et
déconvenues s'accumulant, il est apparu
que les entreprises ne se comportaient
pas comme le postulaient les théories
alors en vigueur, toutes fondées sur une
logique globale telle que la maximisation
du profit. Cela se voyait à ce qu'elles
appliquaient ou rejetaient le résultat
d'une étude en affichant des raisons qui
n'avaient pas été prises en compte dans
les modèles utilisés.
Une tentation aurait pu être d'invoquer l'irrémédiable irrationalité des êtres
humains et de s'en tenir là. Mais l'attention des équipes de chercheurs a été peu
à peu attirée par de frappantes régularités dans ces manifestations réputées irrationnelles. Si tant est qu'une démarche
scientifique consiste à mettre au jour ce
qu'il y a de commun entre des
phénomènes apparemment uniques, c'est
bien un effort de cet ordre qui a abouti à
la théorie exposée assez cohérente,
somme toute. avec les espoirs des années
60: elle postule que tout le monde est
logique, comme dans les modèles de
maximisation du profit: la différence
tient évidemment à ce que toutes ces
logiques locales ne sont plus
harmonisées par une logique globale.
Pendant ce temps, la science
économique prenait acte des
imperfections du modèle d'optimisation
classique, et la théorie exposée ci-dessus
s'est trouvée en résonance avec
d'importants développements
académiques, en particulier l'école de la
"rationalité limitée", associée au nom de
Herbert Simon, prix Nobel d'économie
1978. Il est intéressant de noter les
ressemblances et différences entre ces
approches.
Comme nous, l'école de Simon prend
acte des conflits internes aux
entreprises, bien mis en lumière par R.
Cyert et J. March (A behavioral theory of
the firm, Prentice Hall, 1963), qui
expliquent l'absence de heurts violents
par l'excès de moyens, l'"organizational
slack", qui permet de satisfaire des
exigences contradictoires.
Comme nous, cette école explique
les logiques locales par le fait que tous
les acteurs ne disposent pas des mêmes
informations. Mais une première
différence apparaît dans l'explication de
ces écarts: H. Simon les explique par les
imperfections des bureaucraties internes
et les limitations intellectuelles et
matérielles des acteurs; nous les
expliquons par les différences de
missions telles que les concrétisent les
paramètres de jugement.
Une autre différence apparaît dans
la logique des choix. Pour H. Simon,
chaque décideur s'arrête à une solution
"satisfaisante", le cas échéant loin de
l'optimum; pour nous, il est supposé
rigoureusement logique compte tenu des
jugements qu'il sent peser sur lui.
Ces deux approches ne sont pas
incompatibles. En ce qui concerne les
informations, nous attribuons nous aussi
à l'urgence le faible nombre de
paramètres pris en compte, et en ce qui
concerne les choix, il est possible que
notre agent économique dispose de
diverses solutions qui optimisent ses
paramètres personnels de jugement, et
qu'il s'arrête à la première qui se
présente, comme H. Simon le suggère.
En réalité, les deux constructions ne
répondent pas aux mêmes questions:
l'école de la "rationalité limitée" se
précccupe essentiellement des processus
de décision, et donc des freins que
constituent les insuffisances et les excès
d'information, alors que nous nous
préoccupons des résultats des décisions
et de leurs liens avec les caractéristiques
des décideurs et de leur environnement.
Quoi qu'il en soit, économistes et
chercheurs en gestion ont ainsi rejoint
les sociologues, qui ont toujours décrit
les entreprises comme des lieux
d'affrontements.
Toutefois, la plupart des travaux de
sociologie sont imprégnés de
préoccupations politiques, morales ou,
du moins, critiques. Il est assez rare que
les sociologues abordent les
organisations avec ce point de vue
mécaniste d'ingénieurs, soit en raison de
leur formation, soit en raison de leur
mode particulier de relations aux
terrains.
Cela étant, la théorie présentée
cidessus pourrait être à la limite
rattachée à la sociologie, en tout cas au
niveau des ambitions de cette discipline
telles qu'elles ont été définies par ses
fondateurs comme Auguste Comte et
Emile Durkheim, notamment par leur
souci de bien distinguer les jugements de
réalité des jugements de valeurs.